(+225) 27 22 40 41 98 / 99
Promotion de l’Accès aux Services d’Assainissement Autonome en milieu Urbain (PASAAU)
La Banque Africaine de Développement (BAD), par le biais du guichet de la Facilité Africaine de l’Eau (FAE), a conclu avec la République de Côte d’Ivoire un accord de don le 13 novembre 2019, en vue du financement du Projet de « Promotion de l’Accès aux Services d’Assainissement Autonome en milieu Urbain » (PASAAU).
Ce projet s’inscrit dans la dynamique nationale d’amélioration de l’accès des populations urbaines à des services d’assainissement performants, durables et inclusifs.
Il vise à contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations urbaines à travers le développement d’un système d’assainissement autonome professionnel et durable, appuyé par un partenariat public-privé (PPP) efficace.
De façon spécifiques le projet vise à :
- Renforcer le cadre réglementaire, institutionnel et technique régissant les services d’assainissement autonome en milieu urbain ;
- Déléguer la gestion des services d’assainissement non collectif à des opérateurs privés qualifiés, selon un modèle transparent et axé sur la performance ;
- Améliorer l’accès des ménages urbains aux ouvrages d’assainissement améliorés, à travers des actions de promotion, de sensibilisation et de facilitation de financement ;
- Encourager la participation du secteur privé et la mobilisation de financements alternatifs en faveur de l’assainissement autonome ;
- Renforcer les capacités des acteurs publics et privés impliqués dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des services d’assainissement ;
- Assurer la capitalisation et la diffusion des connaissances générées par le projet, pour orienter les politiques et programmes futurs.
Le projet s’articule autour de trois composantes principales :
- La délégation des services d’assainissement non collectif à des opérateurs privés qualifiés ;
- La promotion de l’accès aux services d’assainissement autonome pour les ménages urbains ;
- La gestion et la capitalisation du projet pour renforcer la gouvernance, la transparence et la pérennité des acquis.
Le Projet a enregistré des résultats significatifs tant sur le plan institutionnel, technique que social notamment :
- Élaboration de textes pour la mise à jour du cadre réglementaire de l’assainissement autonome en Côte d’Ivoire ;
- Mise en place d’un modèle de délégation de services d’assainissement en cours d’expérimentation avec des opérateurs privés ;
- Renforcement des capacités de plus de 60 opérateurs de vidange ;
- Sensibilisation directe de près de 23 000 ménages sur l’hygiène et l’assainissement autonome.
| Documents | Size |
|---|---|
| PROMOTION DE L’ACCES AUX SERVICES D’ASSAINISSEMENT AUTONOME EN MILIEU URBAIN ONAD- 28 Mars 2019 - Novembre 2019 - rapport d'évaluation | 2 MB |
| Documents | Size |
|---|---|
| PROMOTION DE L’ACCES AUX SERVICES D’ASSAINISSEMENT AUTONOME EN MILIEU URBAIN ONAD- 28 Mars 2019 - Novembre 2019 - rapport d'évaluation | 2 MB |
Composante 1 : Délégation des services d’assainissement urbain
Objectif : Les prestations de services améliorés sont délivrées par des privés qualifiés le long de la chaîne d’assainissement urbain
- Diagnostic approfondi de la situation de l’assainissement autonome dans les villes cibles (Abidjan, Bouaké, Korhogo, San Pedro, Yamoussoukro, etc.), mettant en évidence :
- un faible taux d’accès des ménages aux ouvrages améliorés ;
- une absence de contrôle systématique lors de la construction et de l’entretien des installations d’ANC ;
- une faible professionnalisation du transport et une vétusté du parc de vidange ;
- une sous-utilisation du fonds de garantie mis à disposition des opérateurs de vidange ;
- des déséquilibres financiers dans l’exploitation des stations de traitement des boues de vidange (STBV), particulièrement celles de petite capacité (< 300 m³).
- Résultats institutionnels et réglementaires
Le projet a permis de proposer des outils en faveur du renforcement d’un cadre juridique et technique cohérent pour le développement de l’assainissement autonome en Côte d’Ivoire.
Ce sont notamment :
- un Dossier Technique Unifié (DTU) et un arrêté ministériel définissant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif (IANC).
- un arrêté interministériel portant sur le contrôle des installations d’ANC et intégrant la présentation d’un certificat de conformité ANC dans les procédures de permis de construire et de branchement à l’eau potable.
- un contrat-type de délégation de service public (DSP) pour la gestion des stations de traitement des boues de vidange (STBV), accompagnée d’outils de suivi et de contrôle de gestion.
La validation et la mise en œuvre de ces projets de texte contribuera à renforcer la gouvernance sectorielle, à clarifier les responsabilités entre acteurs publics et privés, et à préparer la standardisation nationale des pratiques dans l’assainissement autonome.
- Résultats techniques et opérationnels
Le projet a proposé des améliorations significatives tout au long de la chaîne de valeur de l’assainissement non collectif : accès, collecte, transport, traitement et valorisation.
- a) Sur le maillon “accès”
- Élaboration d’une stratégie nationale de mise en conformité des installations d’ANC, prévoyant :
- La proposition d’un agrément pour les constructeurs d’ouvrages d’ANC et la création d’un organe national de certification pour les produits et systèmes préfabriqués, garantissant la qualité et la conformité des installations.
- Création envisagée d’unités locales de gestion et de contrôle des installations d’ANC au sein des municipalités ou de l’ONAD, assurant la conformité technique et la délivrance des attestations d’exécution des installations ;
- Intégration du certificat de conformité ANC dans le processus de délivrance du permis de construire — une innovation majeure qui renforce la durabilité des ouvrages réalisés.
- b) Sur le maillon “transport et vidange”
Les propositions majeures incluent :
- Une Réforme du processus d’agrément des opérateurs privés de collecte et de transport des boues de vidange (BV), avec une réduction des délais administratifs, la mise en place d’un certificat temporaire d’agrément et une décentralisation des procédures via les Directions Régionales de l’Assainissement ;
- L’Introduction d’outils numériques innovants inspirés du modèle des plateformes VTC (réservation en ligne, planification, suivi GPS, traçabilité des tournées) pour moderniser la gestion de la vidange urbaine à court et moyen terme ;
- L’Instauration d’une délimitation claire des zones d’intervention pour la vidange et l’établissement de conventions de délégation avec des opérateurs agréés pour la réalisation de vidanges planifiées et régulières des ménages selon une périodicité définie, à long terme ;
- c) Sur le maillon “traitement et valorisation”
- Élaboration d’un manuel d’exploitation et de maintenance pour les STBV, afin de garantir leur bon fonctionnement ;
- Élaboration de manuels de suivi, de contrôle et d’évaluation de la performance des exploitants privés ;
- Lancement d’une expérimentation pilote de délégation de gestion de STBV à un opérateur privé, préfigurant le modèle à étendre lors de la prochaine phase ;
- Préparation de missions d’audit pour évaluer la qualité des prestations de l’opérateur dans les villes ciblées.
- Les recommandations formulées, ainsi que les outils élaborés permettront à terme de renforcer la performance et la fiabilité du service d’assainissement autonome, tout en posant les fondations d’un modèle économiquement viable et réplicable.
Composante 2 : Promotion de l’accès aux services d’assainissement
- Résultats en matière de communication et de sensibilisation
Une stratégie de communication promouvant les services d’ANC a été réalisée autours des axes principaux que sont :
- Mobilisation des acteurs (Etat, privés, ménages, PTF et ONG) pour la promotion de l’assainissement Autonome ;
- Appropriation de la Règlementation du secteur de l’ANC à travers une large diffusion auprès des parties prenantes ;
- Accroissement du taux d’accès à des installations d’ANC améliorées par la sensibilisation de masse et de proximité ;
- L’adhésion au processus de Professionnalisation du secteur par les opérateurs de vidange
- Accroissement de la visibilité et l’exploitation des STBV
- Accroissement de l’acceptabilité des produits valorisés
La stratégie de communication du PASAAU a constitué un levier essentiel de changement social et d’appropriation communautaire du projet.
Les principales réalisations incluent :
- La conception et la diffusion d’une campagne multimédia nationale sur l’assainissement autonome, comprenant :
- 36 panneaux publicitaires déployés dans les six villes du projet ;
- 5 capsules audiovisuelles, dont 3 diffusées sur la Radiotélévision Ivoirienne (RTI) ;
- la production et la distribution de 2 000 supports promotionnels (tee-shirts et casquettes) ;
- la collaboration avec des créateurs de contenu digital et humoristes pour des vidéos de sensibilisation diffusées sur les réseaux sociaux.
- La création d’un portail web spécialisé sur le site de l’ONAD, dédié à l’assainissement non collectif, destiné à centraliser les supports de communication, les études et les outils produits.
- La campagne de sensibilisation de proximité, réalisée sur une période de trois mois, a atteint 22 965 ménages (soit 67,2 % de la cible globale), permettant une amélioration significative des connaissances :
| Rubriques | Avant la sensibilisation | Après la sensibilisation |
| % de ménage ayant connaissance de l’existence de plan de construction des ouvrages d’ANC | 11 % | 63 % |
| % de ménage ayant connaissance de l’existence de la STBV dans leur commune | 4 % | 65 % |
| % de ménages ayant connaissance de l’existence d’un agrément délivré aux opérateurs de vidange par le Ministère en charge de l’Assainissement | 13 % | 86 % |
| % de ménage ayant connaissance de l’utilité des boues traitées | 15 % | 76 % |
Cette campagne de communication a permis de renforcer la visibilité du secteur et du projet, de favoriser l’adhésion des ménages et de créer un environnement favorable à la professionnalisation des opérateurs privés.
INSERER DES DIAGRAMMES PRESENTANT LES CHIFFES CLES DE LA CAMPAGNE
- Résultats en matière de financement et d’innovation économique
Le Projet a également contribué à poser les jalons d’un modèle de financement durable du secteur :
- Proposition pour l’optimisation du Fonds de Garantie pour les opérateurs de vidange :
- identification de garages agréés et mise en place d’un mécanisme de financement des réparations remboursables ;
- acquisition envisagée d’un parc de véhicules de vidange neufs accessibles via un système de prêt ;
- intégration potentielle des opérateurs dans le Fonds de Garantie des PME (FGPME).
- Propositions pour un financement élargi des services d’ANC :
- augmentation des budgets communaux dédiés à l’assainissement pour soutenir les ménages vulnérables ;
- mobilisation des institutions de microfinance pour faciliter l’accès au crédit des entrepreneurs et des ménages ;
- extension de la taxe d’assainissement à l’ensemble du territoire pour financer à la fois les services collectifs et autonomes (vidange planifiée) ;
- promotion du partenariat public-privé (PPP) pour la construction et l’exploitation des STBV ;
- valorisation économique des produits issus du traitement (compost, énergie, eau recyclée).
- Recours à la fiscalité environnementale (taxes sur les pollutions de l’eau et sur la production de déchets, etc) et incitations fiscales pour les investisseurs dont les activités contribuent à la protection de l’environnement notamment la construction des STBV, la Valorisation des boues de vidange, etc.
Composante 3 : Gestion du Projet
Objectif : fonctionnement des organes de gestion et capitalisation des informations du projet
Le projet a mis un accent particulier sur la production et la diffusion de connaissances pour renforcer la planification sectorielle et l’efficacité des interventions futures.
- Cinq mémoires universitaires sont en cours finalisation par des étudiants chercheurs issus des universités partenaires, sur des thèmes essentiels tels que :
- le développement d’un modèle économique d’affaire garantissant l’équilibre financier de chaque maillon et de toute la chaine de valeur de l’assainissement ;
- la valorisation agronomique des boues séchées et des eaux traitées ;
- la valorisation énergétique des boues séchées et des eaux traitées ;
- l’impact du projet sur l’amélioration des performances des structures publiques et privées impliquées dans la gestion de l’assainissement non collectif ;
- l’impact du projet sur l’amélioration de l’accès des populations des villes ciblées aux services d’assainissement.
Ces travaux scientifiques contribueront à la constitution d’une base de données nationale sur l’assainissement autonome et à la formation d’une nouvelle génération d’experts nationaux dans le domaine.

Photos
16 octobre 2025
Atelier de partage des résultats du projet PASAAU

Photos
Du 17 au 20 juin 2025
Atelier de renforcement des capacités des opérateurs de vidange à YAMOUSSOUKRO
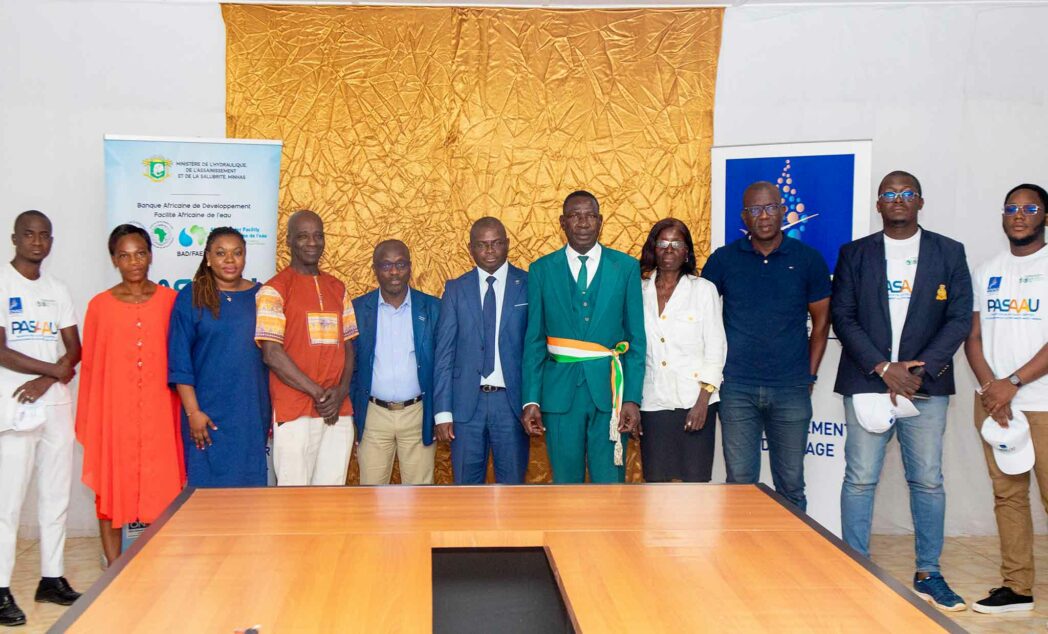
Photos
5 mai 2025
Lancement de la communication de masse et de proximité

Photos
Du 27 au 30 Août 2024
Atelier de renforcement des capacités des opérateurs de vidange à SAN PEDRO

Photos
Du 16 au 19 juillet 2024
Atelier de renforcement des capacités des opérateurs de vidange à ABIDJAN (Anyama)

Photos
Du 16 au 19 juillet 2024
Abidjan : Atelier de formation des vidangeurs

Photos
Du 25 au 28 juin 2024
Atelier de renforcement des capacités des opérateurs de vidange à KORHOGO
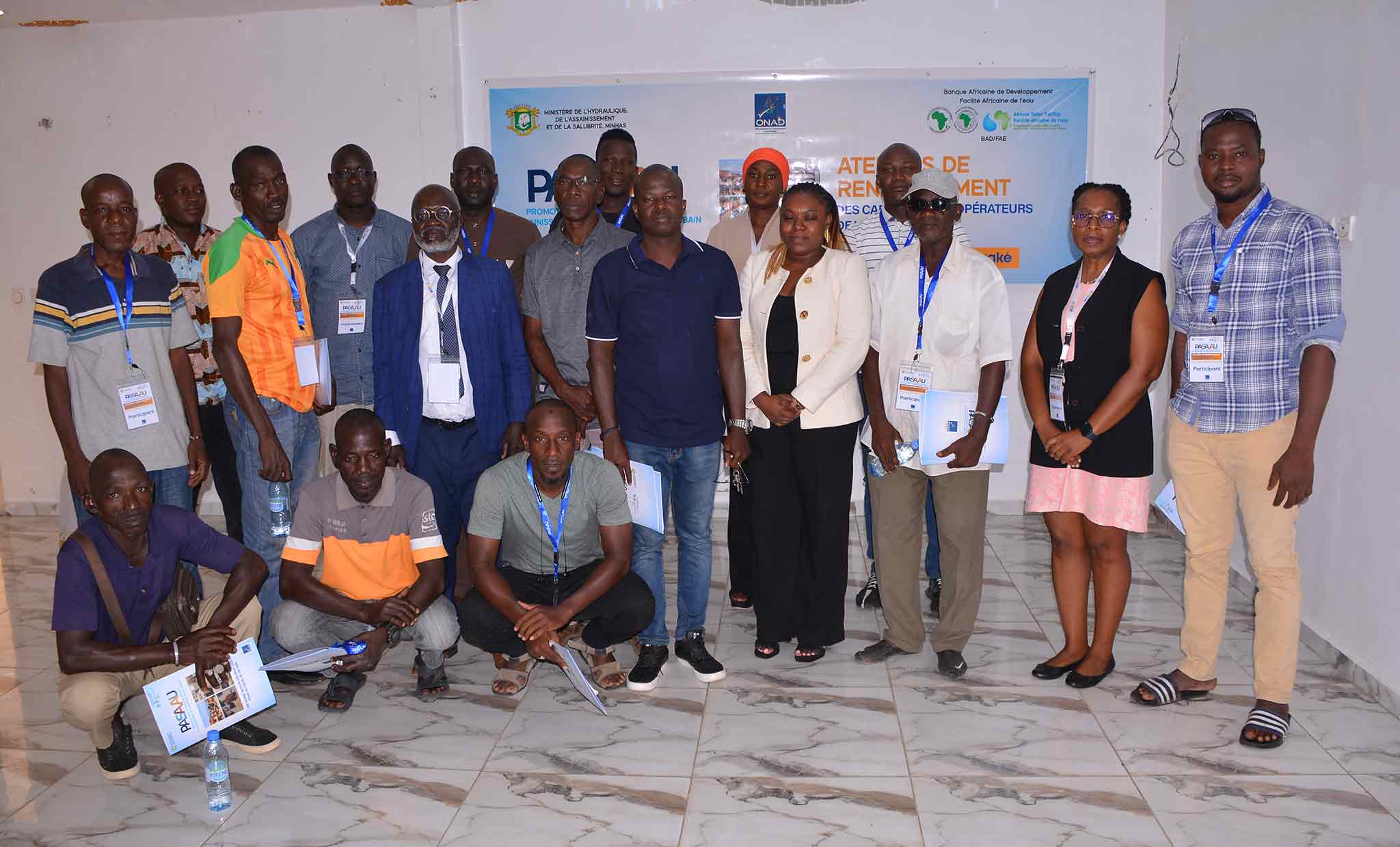
Photos
Du 21 au 24 mai 2024

